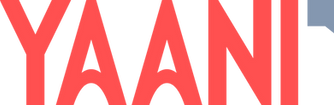Autorité palestinienne

Par Ryan Tfaily, diplômé de Sciences Po Paris et de l’EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales), master Études Politiques.
Lisez également ses articles sur notre site.
Le lexique de Yaani
L’Autorité palestinienne (AP) est le nom donné à l’entité administrative censée gérer les affaires civiles des Palestiniens de Cisjordanie occupée, dans les zones A et B, la zone C étant entièrement sous contrôle israélien. Cette administration naît des Accords d’Oslo, en 1994, entre l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP) et l’État d’Israël. À l’origine, il devait s’agir d’un gouvernement provisoire, dont le mandat était défini pour cinq ans, jusqu’à ce que les deux parties finalisent les négociations. Toutefois, aucun État palestinien pleinement souverain et indépendant n’a vu le jour, et l’AP est devenue une administration pérenne. Son premier président est Yasser Arafat en 1994, alors dirigeant du Fatah et de l’OLP.
Depuis 2006 et la victoire du Hamas aux élections législatives palestiniennes, le territoire gazaoui sous blocus est administré de manière autonome par le Hamas, tandis que le Fatah domine l’AP en Cisjordanie.
Reconnue internationalement comme représentante de l’État de Palestine depuis 2013, l’AP est pourtant un gouvernement sans souveraineté. Si elle dispose d’un corps de fonctionnaires et d’une police civile, elle ne se substitue pas à l’administration militaire israélienne du territoire palestinien illégalement occupé. L’AP ne dispose d’aucun pouvoir en mesure de contrecarrer les ambitions coloniales et annexionnistes d’Israël sur ce territoire. Par ailleurs, depuis le début de l’occupation en 1967, Israël contrôle l’économie palestinienne.
Puissance occupante, Israël utilise l’Autorité palestinienne comme un sous-traitant à moindre coût de l’occupation. L’AP permet à Israël de ne pas assurer ses responsabilités civiles envers la population palestinienne qui est pourtant sous son contrôle, tout en l’aidant dans la gestion dite « sécuritaire » du territoire. La coopération sécuritaire entre l’AP et Israël, extrêmement décriée par la population palestinienne, se traduit concrètement par une collaboration avec l’occupant dans la répression des groupes armés, la surveillance autoritaire de la population, voire une aide dans les opérations militaires contre le territoire.
Démonétisée et réduite à cette fonction de coopération sécuritaire, l’AP souffre également d’un important déficit démocratique. Membre du Fatah, Mahmoud Abbas est élu à la tête de l’administration en 2005. Son mandat a été sans cesse renouvelé depuis, les élections démocratiques étant constamment repoussées. Âgé de 89 ans, il est un président largement illégitime et impopulaire, principalement car les modalités de lutte qu’il envisage, en particulier le recours à la communauté internationale et aux moyens légaux, peinent à se traduire en résultats concrets sur le terrain, où la colonisation, la violence des colons et de l’armée s’intensifient. La population palestinienne reproche également à l’AP sa corruption endémique et son népotisme, qui se manifestent par des emplois fictifs ou une utilisation des fonds dont elle est dotée pour favoriser une élite uniquement.
Ses financements reposent sur l’aide internationale, celle de l’Union européenne, des Nations Unies, des pays arabes comme l’Arabie Saoudite, et des États-Unis, même si Donald Trump, lors de son premier mandat, a coupé les financements américains, avant qu’ils ne soient partiellement rétablis par Joe Biden. Toutefois, Israël exerce depuis longtemps une emprise financière sur l’AP, grâce à des mécanismes de chantage financier. En effet, c’est le Ministère israélien des finances qui collecte les impôts des Palestiniens puis effectue des transferts mensuels à l’AP. Depuis le début de la guerre génocidaire contre Gaza en octobre 2023, Israël a gelé ces transferts, conduisant l’AP au bord de la banqueroute, alors que l’économie palestinienne est déjà en proie à une explosion du chômage et de la pauvreté.
Sources :
Xavier Guignard, « Gaza. Une autorité palestinienne impuissante », Orient XXI, 18 novembre 2024
Megan Giovannetti, « Mafieuse : les Palestiniens en ont assez de la corruption de l’Autorité palestinienne », Middle East Eye, 18 février 2019
Dalia Alazzeh et Shahzad Uddin, « Comment Israël a amené l’autorité palestinienne au bord de la banqueroute », 29 juillet 2024
France Culture, « Autorité palestinienne : une administration détestée », 21 janvier 2025, entretien avec Xavier Guignard et Taher Labadi
Archives
- février 2026
- janvier 2026
- décembre 2025
- novembre 2025
- octobre 2025
- septembre 2025
- août 2025
- juillet 2025
- juin 2025
- mai 2025
- avril 2025
- mars 2025
- février 2025
- janvier 2025
- décembre 2024
- novembre 2024
- octobre 2024
- septembre 2024
- août 2024
- juillet 2024
- juin 2024
- mai 2024
- avril 2024
- mars 2024
- février 2024
- janvier 2024
- décembre 2023
Catégories
© 2025 Yaani Mentions légales.