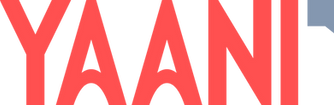Villa dans la jungle

Par Clarisse Genton, docteure en architecture, associée au Laboratoire ACS, ENSA Paris-Malaquais, Université PSL.
Lisez également son article Israël, oasis forteresse plutôt que villa dans la jungle sur notre site.
Le lexique de Yaani
L’expression a été prononcée par Ehud Barack en 1996, lors d’un discours devant la communauté juive de Saint-Louis aux Etats-Unis. Cette métaphore désigne le pays dont il est un représentant politique, Israël, comme une villa qui serait cernée par une jungle, sous-entendant ici toute la région du Moyen-Orient. L’allégorie s’appuie sur une opposition entre deux milieux, celui de la villa et celui de la jungle, diamétralement opposés, pour proposer une narration disqualifiante de la région tout en anoblissant Israël, opposant directement la civilisation au monde sauvage.
Le terme de villa renvoie à une figure architecturale archétypale, dont les origines remontent à l’Antiquité romaine. A cette époque, la villa désigne généralement un domaine foncier rural, comprenant des bâtiments désignés pour une exploitation agricole et une série d’autres bâtiments pour l’habitation. Un corps de logis principal destiné au propriétaire et généralement plus cossu est accolé d’édifices secondaires plus modestes, destinés à loger le personnel. Désormais employée dans le langage courant, la villa définit une grande propriété installée le plus souvent en dehors de la ville, en banlieue ou à la campagne, entourée d’un jardin d’agrément ou d’un domaine, généralement luxueuse et confortable. Parmi les modèles les plus connus de l’histoire de l’architecture, on peut penser aux villas de la région de Rome, la villa Médicis, la villa Borghese, la villa d’Este ou encore la villa Hadriana (en réalité un palais impérial), ou bien encore en Vénétie, les villas de l’architecte Palladio, bâties au XVIè siècle, et inscrites pour vingt-quatre d’entre elles au patrimoine mondial de l’UNESCO, elles ont la particularité d’être toutes conçues sur un plan de neuf carrés, censés incarnés des proportions parfaites basées sur le chiffre d‘or et une pureté des formes. La villa renvoie également à l’idée de plaisance, de villégiature et donc un lieu d’habitation occupé pendant les périodes de vacances ou pour se retirer des inconvénients de la vie en milieu urbain. Elle convoque ainsi une image de calme, voire de luxe, un panorama dépeignant un havre de paix loin de la vie quotidienne, un cadre de vie idyllique pour classe supérieure aisée. De ce fait, Ehud Barack associe Israël à cet environnement idéalisé, une île de modernité, de prospérité et de propreté, une vision définitivement bourgeoise, européenne, mais aussi parangon de la civilisation occidentale. De plus, les villas citées au-dessus appartiennent toutes à des listes de patrimoine classé (nombre de villas remarquables jusqu’aux plus modernes le sont). Cette patrimonialisation acte une sélection de ce qui doit être conservé pour être transmis aux générations futures, et donc choisit ce dont on doit se souvenir du passé. En choisissant ce terme, Ehud Barack renvoie ici aussi à une hiérarchie des histoires et des mémoires, qui le rapproche d’un passé européen (et romain antique) perçu comme prestigieux, pour occulter ce qui a été détruit et oublié.
Dans la métaphore employée par Barack, la villa serait installée au milieu d’une jungle. Il n’est pas dit si la jungle compose le jardin qui entoure la villa ou si elle commence aux limites de celui-ci. Le terme jungle est clairement péjoratif ici. Il désigne un environnement végétal épais, touffu, dense et difficile à pénétrer, dans lequel il est aisé de se perdre, ou de tomber sur un animal dangereux. L’image qui vient ensuite est celle d’un environnement hostile et dangereux, mais également complexe à comprendre, où l’on ne saurait s’aventurer sans risque. De plus, le terme jungle assimile l’environnement qui entoure la villa en une unique entité, non identifiable, indistincte, et qui de ce fait généralise l’entièreté du Moyen-Orient en un unique composant, sans percevoir ou reconnaître ses particularités, ses tensions, ses différences et ses histoires, ce qui là encore efface et assimile les Palestiniens à un grand tout menaçant.
D’un côté, le beau jardin ordonné d’une villa bourgeoise, de l’autre une nature qui n’a pas été maîtrisée par la main de l’homme, un environnement impropre à la vie citoyenne ou à la vie humaine tout court. C’est bien ce propos animalisant qui doit représenter le Moyen-Orient, qui se voit ainsi ramené non seulement à une menace entourant de toute part Israël, mais aussi littéralement rabaissé, sorti de l’humanité. Pour citer Damien Simonneau dans un article de 2017 : « [le terme jungle] stigmatise l’arriération du monde arabe, tend à expliciter l’agressivité « spontanée » de « l’Arabe » envers les valeurs occidentales (dont Israël serait le représentant) et justifie la nécessaire domination des Palestiniens par Israël. » On retrouve clairement un motif orientaliste, très proche des exemples concrets de grandes demeures coloniales en Inde ou en Indochine, mettant en opposition deux environnements incompatibles, affirmant la supériorité de l’un sur l’autre : l’un civilisé et ordonné, et l’autre « sauvage », obscur et dangereux, qu’il s’agirait de domestiquer pour empêcher qu’il envahisse votre territoire, voire la civilisation. Ce qui est justement retenu comme paramètre majeur pour l’établissement d’une civilisation, c’est l’agriculture car elle implique la présence d’un habitat permanent, renvoyant les communautés nomades (les Bédouins par exemple) en dehors de cette définition très occidentalo-centrée, ne tenant pas compte des pays à faible pluviométrie, ou au contraire aux espaces naturels denses, comme les jungles.
Cette expression est une évocation imagée très efficace pour produire un discours dichotomique du « nous » et du « eux », où toute une géographie imaginaire se déploie, c’est-à-dire l’organisation mentale de l’espace qui produit des identités en établissant des frontières, selon la philosophe Wendy Brown. L’ « Autre » n’appartient plus tout à fait à la catégorie des humains, il ne fait pas partie de la civilisation. Ainsi déshumanisé, il devient un barbare dont la sauvagerie légitime le fait qu’on puisse l’attaquer sans scrupule. Edward Saïd dans L’Orientalisme explique à propos de la construction historique de l’Occident par rapport à un Orient fantasmé que : « […] la géographie imaginaire du type « notre pays – le pays des barbares » ne demande pas que ces derniers reconnaissent la distinction. Il « nous » suffit de tracer ces frontières dans notre esprit, ainsi « ils » deviennent « eux », et leur territoire comme leur mentalité sont désignés comme différant des « nôtres ». […] Cependant, il arrive souvent que nous nous sentions non étrangers à cause d’une idée très peu rigoureuse de ce qui est « là-bas », à l’extérieur de notre propre territoire. Toutes sortes de suppositions, d’associations et de fictions semblent se presser dans l’espace non familier, qui est à l’extérieur du nôtre. » L’image coloniale de villa dans la jungle devient une image de protection reprenant les termes de Herzl, évoquant l’État d’Israël à venir comme « un avant-poste de la civilisation contre la barbarie », dont la mission civilisatrice suppose que la villa s’étende sur la jungle.
Archives
- février 2026
- janvier 2026
- décembre 2025
- novembre 2025
- octobre 2025
- septembre 2025
- août 2025
- juillet 2025
- juin 2025
- mai 2025
- avril 2025
- mars 2025
- février 2025
- janvier 2025
- décembre 2024
- novembre 2024
- octobre 2024
- septembre 2024
- août 2024
- juillet 2024
- juin 2024
- mai 2024
- avril 2024
- mars 2024
- février 2024
- janvier 2024
- décembre 2023
Catégories
© 2025 Yaani Mentions légales.