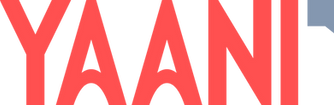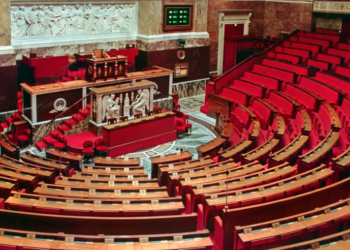Par Clarisse Genton, docteure en architecture, associée au Laboratoire ACS, ENSA Paris-Malaquais, Université PSL.
La villa dans la jungle est une allégorie régulièrement évoquée dans le discours public israélien, depuis que le responsable politique Ehud Barack l’a prononcée en 1996 à Saint-Louis (États-Unis). À cette image orientaliste est parfois accolée ou opposée l’image de forteresse assiégée, toutes deux imposant l’image d’un État isolé et menacé. La réalité des colonies israéliennes impose cependant un autre panorama : celui d’une « oasis forteresse » installée dans le paysage des Territoires palestiniens occupés.

Ces deux images convoquent des figures archétypales qui exploitent la puissance narrative de l’architecture, qui ne se réduit pas à un simple décor des relations sociales, mais qui – pour reprendre Erving Goffman – représente l’un des éléments les plus imposants et fondamentaux de la mise en scène de nos vies quotidiennes. À partir de l’analyse de ces deux images de la hasbara israélienne, j’invoque une nouvelle métaphore, directement issue de mon travail de recherche, de mes arpentages et observations dans plusieurs colonies de Jérusalem-Est et de Cisjordanie, ainsi que des relevés des espaces domestiques d’appartements dans les colonies de Ramot (Jérusalem-Est) et de Ma’ale Adumim (Cisjordanie). Il s’agit de penser Israël à partir des espaces urbains et domestiques des colonies post-1967, et non l’inverse, pour éclairer la manière dont le pays pense et réfléchit son espace territorial depuis le début de l’installation sioniste en Palestine.
« Il s’agit de penser Israël à partir des espaces urbains et domestiques des colonies post-1967, et non l’inverse, pour éclairer la manière dont le pays pense et réfléchit son espace territorial depuis le début de l’installation sioniste en Palestine. »
Villa ou forteresse assiégée, deux figures déformantes de la réalité
Décrivant une grande propriété bourgeoise entourée d’un domaine, la popularité de l’expression d’Ehud Barack « la villa dans la jungle » est aussi due au développement du modèle pavillonnaire qui a essaimé dans les années 1980, aussi bien en Israël, dans ses colonies, qu’ailleurs dans le monde occidental. Le terme de « villot », pour villa au pluriel en hébreu, désigne les unités de logement dessinées sur un modèle pavillonnaire par la promotion immobilière à partir du milieu des années 1980, directement dans le prolongement du mouvement des Bneh Baitra. Littéralement « Construis ta maison », ce programme lancé pendant l’ère de Menahem Begin (1977-1983) encourageait les habitants à bâtir leur logement. Les années qui ont suivi ont vu pulluler, en Israël et dans les colonies, nombre de pavillons individuels entourés d’un jardin. Son signe le plus reconnaissable, le toit double pente en tuiles rouges, est devenu le signe le plus reconnaissable des colonies, surtout en Cisjordanie, un emblème visible de loin, qui marque le paysage. Ce toit se trouve aussi bien en couverture de pavillons individuels que d’immeubles de grandes hauteurs, les assimilant à une typologie plus raisonnable et surtout plus occidentale de l’habiter. La puissance d’évocation de la « villa dans la jungle » fonctionne donc non seulement à l’échelle du pays, mais également à l’échelle de ses colonies.
Tout comme la villa dans la jungle évoque un îlot civilisateur au milieu de la barbarie, l’image de la « forteresse assiégée » montre un Israël seul au milieu de ses voisins menaçants. Si l’idée militaire de forteresse peut être validée, la configuration géopolitique actuelle ne présente absolument aucun état de siège vis-à-vis d’Israël. Le pays a signé plusieurs traités de paix avec l’Égypte et la Jordanie, deux de ses voisins directs. Il était sur le point de conclure des traités économiques amenant à sa normalisation dans la région, les fameux traités d’Abraham. Israël occupe le Golan syrien, voisin dont aucune menace ne provient depuis 1973, et ses troupes se trouvent encore au sud du Liban. L’occupation et la colonisation de la Cisjordanie produisent un état d’Apartheid, quand la bande de Gaza subit un blocus depuis 2007 et a vécu deux années de guerre de siège que plusieurs associations et institutions de la communauté internationale décrivent comme un génocide. Utiliser cette métaphore revient à gravement inverser la réalité du terrain et les responsabilités des acteurs en jeu. Plutôt que d’employer des figures architecturales générales, car les images qu’elles créent possèdent une puissance évocatrice, il nous faut repartir de la description de l’architecture des colonies, précisément parce que ces endroits ne bénéficient pas de la légitimité acquise par l’État d’Israël depuis l’armistice de 1949.
La tour de surveillance depuis le salon
L’architecture des logements dans les colonies ne diffère pas fondamentalement de celle des logements dans le reste du pays. En ce sens, le politiste Marco Allegra a montré que les colonies ne sont pas des entités autonomes, détachées du reste du pays, ni géographiquement, ni historiquement. Ce qui fait leur spécificité, c’est la répartition typo-morphologique des bâtiments dans le tissu urbain, qui dépend précisément de la topographie où elles s’installent. Cet ensemble architectural, urbain et paysager crée un panorama spécifique.
Les colonies subventionnées par le gouvernement depuis 1967 sont toutes dessinées selon le même modèle urbain : au sommet d’une colline, la colonie se développe depuis le sommet vers la pente, les services urbains au centre, et le résidentiel autour, le réseau routier suit scrupuleusement les courbes de niveau, avec une gradation qui permet d’installer les rues piétonnes au centre des îlots ouverts pour garantir une circulation sûre aux piétons. La végétation est systématiquement soignée, parfois même luxuriante, quel que soit l’environnement géographique autour. Le maire de Ma’ale Adumim, Benny Kashriel, parle de sa ville comme d’une « oasis », créée dans un environnement semi-aride, à grand renfort d’une consommation d’eau qui épuise les aquifères locaux. Les parcelles d’abord larges, sont ensuite découpées de façon régulière et continue pour s’installer le long des routes depuis la fin des années 1970. Cela prépare les terrains pour des unités d’habitation individualisées et non plus collectives. Autre itération, toutes les unités de logement sont implantées de telle manière qu’elles se dirigent systématiquement vers l’extérieur de la colonie, dans le sens de la pente. Depuis l’espace urbain jusqu’à l’espace domestique, les espaces sont dessinés de telle manière qu’ils favorisent le cadrage des vues vers l’extérieur de la colonie.
Cette omniprésence de l’ouverture vers l’extérieur ne doit rien au hasard. Les architectes Rafi Segal et Eyal Weizman indiquent que ce souci de conception apparaît clairement dans les contraintes imposées aux architectes. Toutes les fenêtres principales sont ainsi tournées vers l’extérieur, transformant une unité urbaine en véritable dispositif panoptique de surveillance à grande échelle, réifiant une multiplicité de tours de surveillance du principe de « prison » de Jeremy Bentham, où le prisonnier ne peut jamais échapper au regard de ses geôliers. Le juriste et politologue Neve Gordon explique que dans les colonies israéliennes cette prolifération dépasse le modèle de Bentham pour se rapprocher du concept panoptique de Michel Foucault, car le regard n’est plus localisé dans des sites identifiables, mais dispersé sur le terrain, permettant la surveillance des habitants locaux depuis de nombreux endroits. On retrouve ce dispositif panoptique dans le modèle de la Homa Oumigdal (tour et muraille), un type de kibbutz offensif inventé en 1936 et qui s’est propagé en Palestine mandataire jusqu’en 1939. La construction sommaire comprenait un mur, quatre baraquements et une tour, facilement transportable et montée dans la nuit par les habitants du kibboutz le plus proche. Sharon Rotbard explique comment la tour du campement doit voir les alentours à 360° et être vue des autres tours. Elle agit comme « un œil qui voit tout sauf lui-même », sa dimension stratégique tenant au réseau formé sur le territoire, couvrant une zone de surveillance d’ampleur et défendant une position tactique avantageuse. Il n’est pas anodin que ce soit ce modèle de kibboutz qui ait directement inspiré les premiers colons sionistes religieux après 1967.
Dresser une forteresse pour désigner l’ennemi
Les premières décennies de la colonisation ont favorisé d’abord des modèles de logement collectif, de hauteur modeste à moyenne, puis un modèle pavillonnaire, pour ensuite se verticaliser, se massifier et se fortifier dans les années 1990. C’est entre 1987 et 1995 que se situe ce tournant typologique : concomitamment à la première Intifada, les pays de l’ex-URSS ouvrent leurs frontières avec une Alyah de près d’un million de personnes qui arrivent en Israël, tandis que l’orientation politico-économique du virage néolibéral adopté dans le courant des années 1980 change la politique du logement israélienne. Les travaux de la politiste Ravit Hananel montrent que la crise financière survenue en 1984 a conduit les gouvernements successifs à brutalement déléguer le secteur au privé, vidant le Ministère du Logement de ses anciennes prérogatives et de son généreux budget, pour ne conserver la mainmise que sur la planification. Les promoteurs immobiliers deviennent alors les premiers acteurs de la construction de logements et répondent aux projets de nouveaux lotissements en se conformant aux quotas toujours plus élevés fixés par le ministère de l’Intérieur qui désigne également les zones prioritaires où construire.
La guerre du Golfe a aussi eu pour conséquence de réviser les normes de construction, en obligeant les concepteurs à équiper tous les appartements en pièces de sécurité individuelles et non plus collectives, déplaçant ces dernières du centre du bâti vers les extérieurs, et respectant un certain nombre de normes sécuritaires édictées par l’armée : parmi celles-ci, des murs deux fois plus épais qu’un mur porteur, des fenêtres standardisées aux dimensions réduites et l’installation de portes et de volets spéciaux en acier. Les portes blindées s’ouvrent vers l’extérieur et non l’intérieur de la pièce, avec une poignée battante spéciale et le volet couvre d’un seul tenant l’ouverture pour se rabattre rapidement et combler complètement la fenêtre. Chaque immeuble construit depuis 1991 compte quatre colonnes aux murs plus épais qui structurent d’emblée toute leur morphologie. À ces normes s’ajoute une obligation de renforcer le verre des fenêtres des habitations situées non loin de localités palestiniennes, donc principalement les colonies, pour résister aux balles des snipers, expose l’architecte et urbaniste Rachel Kallus.
On assiste alors à une fortification accrue du bâti résidentiel. Cette sécurisation a tendance à militariser les espaces de vie des civils. Cela a considérablement alourdi les volumes des bâtiments construits ces trois dernières décennies. Le développement urbain induit également une implantation plus basse de ces immeubles à flanc de collines. Par conséquent, ce sont nécessairement ceux qui entourent les colonies. Leurs fondations sont installées dans la pente de manière à ce que depuis la rue à l’intérieur, ils apparaissent comme des immeubles à deux étages (R+2), alors qu’ils comptent régulièrement huit étages, parfois plus, visibles depuis la vallée ou l’extérieur de la colonie.
Ces éléments révèlent un processus de fortification et la façon dont l’environnement résidentiel se développe comme arène politique, exposé comme un champ de bataille où se déroulent des luttes géopolitiques. En outre, la présence de barreaux aux fenêtres, élément commun à tous les immeubles toutes années de construction confondues, renforce ici l’impression de fermeture, que la fortification même des immeubles exacerbe déjà. L’habitat, base de la vie quotidienne, devient gardien du territoire national, en servant véritablement de frontière fortifiée. Au centre, l’environnement urbain le plus bas et le plus végétalisé – oasis totalement fabriquée – sur les extérieurs, des volumes très hauts, très épais, similaires, édifiés de manière très serrée, les uns à côtés des autres, forment littéralement un mur urbain qui s’apparente à une forteresse.
« L’habitat, base de la vie quotidienne, devient gardien du territoire national, en servant véritablement de frontière fortifiée. Au centre, l’environnement urbain le plus bas et le plus végétalisé – oasis totalement fabriquée – sur les extérieurs, des volumes très hauts, très épais, similaires, édifiés de manière très serrée, les uns à côtés des autres, forment littéralement un mur urbain qui s’apparente à une forteresse. »
L’oasis forteresse suggère une hybridité paradoxale, pour dresser le portrait d’un environnement idyllique très protégé, qui dresse un double visage en fonction de celui qui le regarde : depuis l’intérieur des colonies, des villes essentiellement résidentielles, au traitement paysager soigné, à l’aménagement sûr pour les piétons, depuis l’extérieur, un épais mur bâti aux multiples points de surveillance. La ceinture formée par les immeubles les plus récents ne protège en réalité que peu les habitants, sa forme suggère une protection qu’en réalité elle ne fournit pas. Sa présence est donc principalement performative et sert à désigner clairement l’ennemi. S’opère alors une inversion de l’agressivité : si dans la villa dans la jungle, c’est la jungle qui est menaçante, ici, c’est la forteresse qui dresse une image volontairement agressive à son environnement extérieur. Derrière la métaphore de la « villa dans la jungle », qui se réfugie derrière une image valorisatrice pour ne jamais regarder en face la violence coloniale qu’elle produit, apparaît l’image d’une oasis forteresse qui surplombe les territoires de la Palestine occupée.