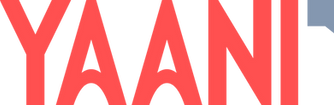Propos recueillis par Thomas Vescovi, doctorant en science politique et membre de Yaani.
Ce 25 septembre, la sociologue et membre de Yaani, Caterina Bandini, a fait paraître aux éditions Karthala–IISMM son premier ouvrage intitulé Une cause sacrée. Religion, décolonisation et mobilisations pour la paix en Israël-Palestine. Fruit de sa thèse et de ses enquêtes de terrain, la sociologue y propose une lecture alternative du militantisme religieux pour la paix en Palestine-Israël, qu’elle interroge de manière critique au prisme des settler colonial studies. Elle a d’ailleurs co-dirigé le dernier numéro de la Revue internationale de politique comparée, dédié au paradigme du colonialisme de peuplement.
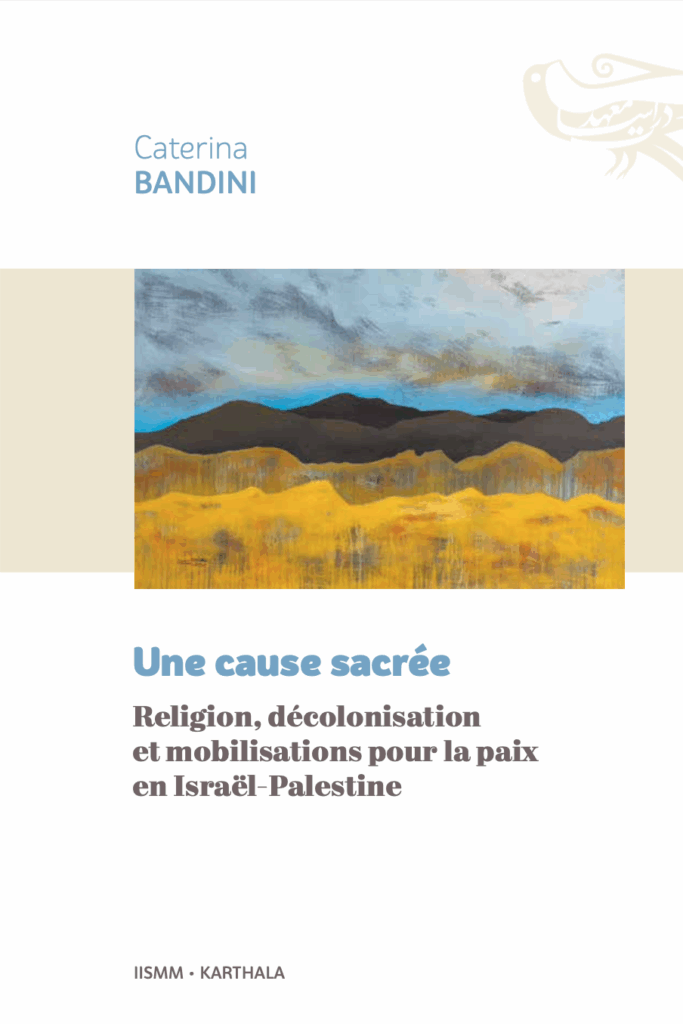
Ton livre s’inscrit à rebours des analyses qui corrèlent l’engagement religieux en politique et la production de violence, en mettant en lumière un militantisme qui affirme agir pour la « paix » entre Israélien·nes et Palestinien·nes. Qu’est-ce qui t’a motivée à réaliser cette recherche dans le cadre de ton doctorat de sociologie politique ?
Il y a tout d’abord ma trajectoire personnelle, celle d’une arabisante qui part en Palestine dans un cadre militant par le biais d’une association italienne, Operazione Colomba. Il s’agit d’une association laïque mais avec des racines catholiques jusqu’à aujourd’hui très présentes. J’avais 22 ans à l’époque et j’ai vécu plusieurs mois dans le village d’At-Tuwani à Masafer Yatta, où j’ai rencontré pour la première fois des jeunes de ma génération, italien·nes, qui étaient issu·es de ce milieu catholique de gauche qui n’est pas du tout mon milieu social d’origine. J’ai commencé par étudier ce militantisme catholique de solidarité internationale, avant de décider de poursuivre ma recherche sur le militantisme religieux de mouvements locaux, palestiniens et israéliens.
L’idée était de regarder comment peuvent tenir ensemble des croyances et des pratiques religieuses avec un engagement qui peut être qualifié, vu de l’extérieur, de « progressiste ». Précisons dès à présent que, comme je le montre dans le livre, « progressiste » est une catégorie qui ne veut pas dire grand-chose car parmi les acteurs et actrices que j’ai étudié·es, il y a des positionnements politiques extrêmement divergents.
À cette trajectoire personnelle s’ajoute une insatisfaction ressentie face aux recherches en sociologie des religions ou aux travaux de politistes sur la religion, mais aussi à la manière par laquelle le sujet était abordé dans le champ médiatique. La plupart des travaux qui étudient les liens entre religion et engagement militant le font en effet au prisme des mouvements conservateurs ou réactionnaires, et de la violence politique. Évidemment, cela tient aussi au contexte français avec notamment une prolifération de travaux sur la radicalisation et le terrorisme.
Ma démarche était de faire un pas de côté, d’aller voir ce qui se passe ailleurs et de montrer à quel point, finalement, cette ressource religieuse est extrêmement plastique et ambivalente. Je dois préciser que je ne me considère pas ici comme une pionnière, je m’inscris plutôt dans le sillon de ces chercheur·es qui, à la suite de Bourdieu entre autres, se sont attaché·es à montrer comment le langage religieux peut traduire des discours très différents, voire antagoniques entre eux. Si je dois prendre un exemple concret tiré de mon propre terrain, c’est très parlant : en s’appuyant sur l’Ancien Testament, des militant·es pour la « paix » développent des argumentaires politiques diamétralement opposés à ceux de leurs adversaires.
Enfin, le pas de côté était aussi par rapport aux travaux sur le dialogue interreligieux ou à cette accumulation de recherches sur l’islam dès lors qu’on étudie la relation entre religion et politique, pour regarder davantage du côté chrétien et juif. C’est, je crois, ce qui fait aussi l’originalité de mon travail, même si je ne l’avais pas décidé au préalable, c’est une réalité qui s’est imposée au travers de la rencontre avec des acteurs et actrices sur le terrain.
Justement, parmi ces acteurs et actrices, nous découvrons aussi des associations de colons israélien·nes installé·es en Cisjordanie. Cela interpelle puisqu’il est censé s’agir de discours de « paix ». Dès lors, qu’est-ce que ces acteurs et actrices entendent par « paix » ? Quel sens lui donnent-iels ?
Cette question fut le grand chantier de ma thèse, mais pour autant je n’y apporte pas de réponse définitive, tout du moins je ne cherche pas à définir la « paix » au travers de mon enquête. Je montre que justement, il s’agit là aussi d’une catégorie extrêmement plastique et ambivalente, qui recouvre un tas de visions différentes en fonction des individus et des groupes. Le point qui me paraît central, c’est de constater que cette catégorie, la « paix », a été largement délégitimée dans la société palestinienne et la gauche radicale israélienne, mais aussi au sein du mouvement de solidarité internationale. La décrédibilisation de ce type de discours est liée au fait qu’il provient d’une doctrine libérale accusée de cacher la réalité des rapports de domination coloniaux.
« Sauf que les militant·es que j’étudie, s’iels continuent de mobiliser ce terme, c’est précisément parce qu’iels le lient à une conception religieuse de leur engagement, sous la forme d’une transcendance, voire d’une mission divine. C’est la raison pour laquelle la « paix » continue d’avoir une place prépondérante dans les mouvements que j’ai étudiés, en dépit de nuances très importantes. »
Sauf que les militant·es que j’étudie, s’iels continuent de mobiliser ce terme, c’est précisément parce qu’iels le lient à une conception religieuse de leur engagement, sous la forme d’une transcendance, voire d’une mission divine. C’est la raison pour laquelle la « paix » continue d’avoir une place prépondérante dans les mouvements que j’ai étudiés, en dépit de nuances très importantes. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le titre du livre ne se cantonne pas au mot « paix », puisque j’ai ajouté la notion de « décolonisation » qui revient régulièrement dans les discours de mes enquêté·es, y compris de celles et ceux qui se trouvent dans une position complètement paradoxale.
Certaines associations parlent de « paix » en conjuguant leur propos avec les notions de libération et décolonisation des Textes sacrés, à l’instar de la théologie de la libération palestinienne, portée notamment par l’ONG palestinienne chrétienne Sabeel. D’autres, principalement des organisations juives de défenses des droits humains comme Rabbis for Human Rights, préfèrent y adjoindre un engagement contre l’occupation. Du côté des groupes fondés par des colons, il s’agit pour l’essentiel de lier le discours de « paix » à une volonté de dialogue avec l’Autre – c’est le cas de l’ONG Roots. Pour ces derniers, l’usage du concept de « décolonisation » vise à une forme de « désoccidentalisation du judaïsme », mais qui, dans certains cas, ne vient pas du tout remettre en cause leurs privilèges liés à l’ordre colonial. C’est très paradoxal, comme je le montre dans mon travail.
Ton livre permet également de comprendre, avec pédagogie, le paradigme du colonialisme de peuplement. Tu mets par exemple en avant le phénomène du redwashing dans certaines associations que tu as étudiées. Peux-tu en parler et expliquer l’importance pour ton sujet ?
Le redwashing, qu’on pourrait traduire par « auto-indigénisation », désigne ce processus de la part d’une population coloniale pour se présenter, ou se représenter, elle-même comme indigène ou autochtone. C’est un enjeu qui est régulièrement analysé dans les études sur le colonialisme du peuplement, puisque c’est en particulier dans les situations de colonisation de peuplement que nous constatons la présence de ce phénomène et surtout que nous pouvons le voir aboutir en quelque sorte, avec des sociétés coloniales qui finissent véritablement par « s’indigéniser » via une croyance très ancrée dans la société elle-même et une reconnaissance extérieure de leur « indigénité ». Dans les autres formes de colonialisme, c’est soit moins présent, soit il a moins de chances d’aboutir.
Or je rejoins la position de Mahmood Mamdani et d’autres chercheur·es, sur le fait qu’un·e colon ne pourra jamais être un·e autochtone : seul le démantèlement de l’ordre colonial peut mener à l’implosion de l’opposition colon/autochtone. Cependant, au travers de mon enquête, je montre que ces activités de dialogue inter-religieux, y compris dans des espaces marginaux comme entre des colons et des Palestinien·nes, mènent à un questionnement de certain·es Palestinien·nes sur la manière d’inclure les Juif·ives israélien·nes dans la société palestinienne. L’hypothèse que j’avance dans le livre est que ces témoignages que j’ai recueillis de la part de Palestinien·nes sont le produit de ces interactions.
Il me faut tout de même mettre l’accent sur le fait que tous les processus de redwashing ne s’équivalent pas. C’est la raison pour laquelle je prends au sérieux les colons de Cisjordanie engagé·es dans ces organisations, y compris dans leur propre réflexivité. Le fait qu’iels cherchent à s’auto-indigéniser par le biais du dialogue les amène à reconnaître, d’elles et eux-mêmes des positionnements très inconfortables. S’iels témoignent de ce paradoxe, c’est aussi par l’écoute des récits palestiniens. À l’inverse, les discours d’auto-indigénisation portés par des militant·es ou des politicien·nes israélien·nes d’extrême droite opposé·es à toute interaction avec les Palestinien·nes ne se fondent sur aucune démarche de dialogue ou de volonté de comprendre l’Autre.
C’est la raison pour laquelle je distingue, même parmi les associations de ce petit milieu (Roots, The Home, Alternative Action, etc.), celles qui traduisent ces engagements par une vision politique où les Palestinien·nes ont une véritable place, égalitaire, et celles qui ne pensent que sous la forme de la domination. Mais j’analyse aussi que, même dans la première situation, cette place ne correspond pas au processus de décolonisation comme l’entendent la plupart des Palestinien·nes.
Dans ton dernier chapitre, tu témoignes effectivement d’une variété de solutions défendues par ces associations. Quelles sont-elles ? Et dans quelle mesure leurs positions ont-elles évolué après le 7-Octobre ?
Ces associations ne défendent pas une solution en particulier. La plupart se montrent plutôt agnostiques, au sens où elles n’ont pas d’opinion officielle sur une solution ou sur une autre. Là où les entretiens s’avèrent décisifs, c’est qu’ils permettent de saisir les positionnements individuels. Dans ma thèse, j’avais accordé une place importante à toutes les solutions envisagées, à savoir à un ou deux États et sous des modalités différentes, mais j’ai décidé de ne pas tout garder dans le livre car il m’a semblé plus intéressant d’accorder une place significative à des solutions alternatives qui sortent de cette dichotomie. Je trouve qu’il s’agit d’une contribution plus originale au débat.
La solution alternative que j’ai étudiée est celle du projet de fédération ou confédération. Il s’agit d’une idée qui a une généalogie très ancienne, et sur laquelle je reviens. Cette solution peut être séparée en deux catégories. D’un côté, le modèle fédéral qui se dote d’une étiquette plus égalitaire mais masque tout de même des visions annexionnistes et d’extension de la souveraineté israélienne à l’ensemble du territoire, via une cantonalisation et une autonomie relative des différents cantons. Ce modèle rappelle celui des Bantoustans sud-africains. Surtout, il ne reconnaît que des droits individuels, et non les droits nationaux des Palestinien·nes. Cette idée, je l’ai essentiellement entendue du côté des groupes formés par des colons.
« Dans le même temps, les mobilisations de solidarité à travers le monde en faveur de la Palestine ont remis la décolonisation à l’ordre du jour. Et cela ne rend que plus criant à quel point les solutions défendues par ces associations ne correspondent pas véritablement à une forme de décolonisation. »
De l’autre côté, le modèle confédéral est principalement incarné par l’ONG A Land for All. L’élément central ici, susceptible de parler à certain·es militant·es religieux·ses, est la notion de reconnaissance mutuelle et d’indivisibilité de la terre. Dans leur perspective, de la Méditerranée au Jourdain, ce n’est qu’un seul territoire habité par deux peuples, donc il convient de trouver un moyen d’empêcher la séparation et de reconnaître les droits, non seulement individuels, mais aussi collectifs aux deux peuples.
Concernant les évolutions post-7-Octobre, j’ai réalisé un court terrain en 2024 où j’ai pu constater que tous ces discours se heurtent désormais, et bien plus qu’auparavant, à l’épreuve des faits, à savoir une situation où l’annexion de la Cisjordanie n’est plus de facto mais de jure. Dès lors, tout paraît encore plus utopique, même si paradoxalement, A Land for All constate avoir gagné du terrain car elle a davantage de visibilité.
Dans le même temps, les mobilisations de solidarité à travers le monde en faveur de la Palestine ont remis la décolonisation à l’ordre du jour. Et cela ne rend que plus criant à quel point les solutions défendues par ces associations ne correspondent pas véritablement à une forme de décolonisation. D’abord parce qu’il n’y a pas de rupture complète avec la doctrine d’Oslo et la solution à deux États, ensuite parce que la mentalité coloniale se maintient. Toutefois, cette nouvelle configuration amène à de nouvelles interrogations où des militant·es développent, à l’échelle individuelle, des approches beaucoup plus décoloniales, mais soutiennent qu’une confédération serait une bonne étape « intermédiaire », à un moment où la solution à un État « de tou·tes ses citoyen·nes » paraît plus lointaine que jamais.
Tu termines ton livre par un plaidoyer en faveur d’une recherche située de la Méditerranée au Jourdain, c’est-à-dire dépassant le cadre traditionnel des études israéliennes et palestiniennes. Tu considères que cela ne va pas encore de soi ?
Non, cela ne va toujours pas de soi. S’il y a des recherches, depuis une quinzaine d’années, qui dépassent cette fragmentation des champs d’étude, cela me paraît être encore trop marginal. Et les raisons pour cela ne sont pas toutes mauvaises. Déjà, il y a un aspect pratique lié au contexte d’occupation coloniale, à savoir qu’en fonction de l’identité du ou de la chercheur·e, l’accès au terrain peut être restrictif. Tou·tes les chercheur·es ne peuvent pas faire de terrain sur l’ensemble du territoire situé entre la Méditerranée et le Jourdain. Ensuite, il y a une réalité linguistique. Engager une recherche sur tout le territoire implique de connaître l’arabe et l’hébreu, ce qui n’est pas toujours le cas. Enfin, il y a une question d’ordre épistémologique et politique, à savoir que tout ne se subordonne pas, dans les sociétés israéliennes ou palestiniennes, aux enjeux conflictuels. Comme le pointait Ibrahim Abu-Lughod déjà en 1981, il est tout à fait nécessaire d’aller étudier ce qui existe, dans ces deux sociétés et dans la société palestinienne tout particulièrement, en dehors de cette conflictualité coloniale.
Mon discours est le suivant : la recherche a besoin des deux. À la fois de chercheur·es qui développent une spécialisation sur l’une des deux sociétés, et d’autres qui se consacrent à en étudier les interactions en contexte colonial.