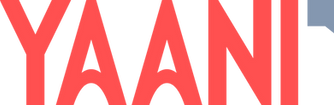Propos recueillis par Victor Auburtin, étudiant en master de politiques publiques à Sciences Po et stagiaire au sein de Yaani.
À l’occasion de la sortie de son dernier ouvrage Le Proche-Orient, miroir du monde. Comprendre le basculement en cours, Ziad Majed, politologue et professeur à l’Université américaine de Paris, a accordé un entretien à Yaani. Son ouvrage tente d’expliquer les mutations en cours au Proche-Orient (génocide à Gaza, guerre et transformations politiques au Liban, nouveau pouvoir en Syrie) par l’analyse de sept moments clés dans l’histoire contemporaine de la région.
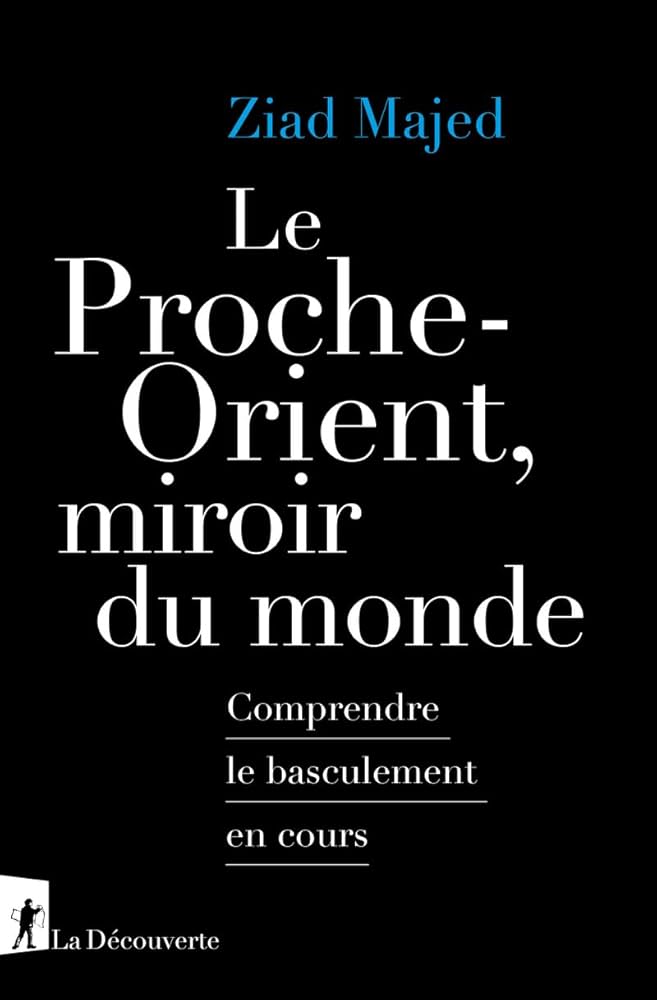
Au moment où cet entretien est enregistré, les modalités de l’accord de cessez-le-feu à Gaza sont dévoilées. Comment analysez-vous cet accord et les modalités de son obtention ?
Il y a deux niveaux d’analyse. Le premier niveau traite des faits qui ont poussé Donald Trump à imposer ce cessez-le-feu. Les alliés américains, européens et du Golfe ont mis beaucoup de pression pour qu’un accord soit signé ces derniers temps. Les rapports des services de renseignements démontraient également qu’il n’y avait plus d’opérations militaires importantes à Gaza, mais bien un processus de destruction massive. Trump n’est bien évidemment que peu importuné par cela, mais une partie de sa base électorale – notamment les jeunes Républicains de moins de 40 ans – se pose des questions sur les intérêts américains de poursuivre ce soutien inconditionnel à Israël. Trump souhaite aussi inscrire son nom dans l’histoire, dans une logique de Prix Nobel.
Le deuxième niveau de l’analyse se trouve dans le registre politique, car ce cessez-le-feu occulte énormément de points essentiels, comme le droit international, le droit à l’autodétermination, l’occupation israélienne, les crimes commis par Israël, etc. La logique de ce cessez-le-feu est une logique immobilière, propre à la culture de Trump – issu de l’immobilier –, tout comme son envoyé spécial pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff; son envoyé pour le Liban et la Syrie, Tom Barrack; et son gendre Jared Kushner, connecté à des colonies en Cisjordanie. Pour eux, reconstruire physiquement des bâtiments, avec des potentiels projets d’îles artificielles construites avec les millions de tonnes de débris, et normaliser la situation par l’économie sous une administration de « technocrates » est plus que suffisant. La question de l’émergence d’un État palestinien viable est pour le moment balayée, d’où l’importance de poursuivre la mobilisation partout dans le monde.
Venons-en à votre ouvrage. Le premier événement que vous analysez en détail est la déclaration Balfour de 1917. Pourquoi ce choix ?
L’idée de l’ouvrage est de revenir sur 100 ans d’histoire politique au Proche-Orient pour répondre au refus de contextualisation auquel on assiste depuis le 7 octobre et pour montrer que cette histoire est accessible. Il y a un fil conducteur dans cette histoire, que je tente d’analyser à travers huit « moments ». Le premier « moment », c’est l’effondrement de l’Empire ottoman et les accords de Sykes-Picot, qui dessinent les cartes de la région. Dans ce contexte-là, la déclaration de Balfour est certainement l’événement le plus important pour différentes raisons.
Cette déclaration incarne une politique coloniale arrogante qui offre à un mouvement national européen – le mouvement sioniste – un foyer national en Palestine, sans prendre en considérations les aspirations ou les droits des Palestiniens, qui n’ont d’ailleurs pas été qualifiés de Palestiniens mais de « populations non-juives » dans la déclaration, alors qu’ils représentaient 95% de la population. Balfour a donc offert une terre peuplée en préparant sa dépopulation et son nettoyage ethnique pour répondre à un problème européen. En effet, les pogroms et les crimes antisémites, tout comme le projet sioniste lui-même, étaient des « questions européennes », qui ont été transformées par la déclaration Balfour en « problèmes palestiniens ».
« Cette déclaration incarne une politique coloniale arrogante qui offre à un mouvement national européen – le mouvement sioniste – un foyer national en Palestine, sans prendre en considérations les aspirations ou les droits des Palestiniens, qui n’ont d’ailleurs pas été qualifiés de Palestiniens mais de « populations non-juives » dans la déclaration, alors qu’ils représentaient 95% de la population. »
Je souhaite préciser, par ailleurs, que le Lord Balfour, issu d’un milieu où l’antisémitisme était normalisé, considérait que tous les juifs allaient s’emparer de cette déclaration, que ce soient les juifs dans la révolution bolchévique, qu’il voyait séduits par sa démarche et garder la Russie dans la Première guerre mondiale, les juifs américains, qu’il considérait puissants auprès du président Wilson, ou les familles juives européennes, automatiquement considérées comme influentes.
Ce logiciel de l’antisémitisme, que Balfour a adopté, a eu des conséquences tragiques au Proche-Orient, car sans cette déclaration, et sans la barbarie nazie contre les juifs en Europe, la question palestinienne ne seraient pas ce qu’elle est aujourd’hui.
Vous revenez également sur la longue « guerre contre le terrorisme » menée dans la région. Quels ont été les effets sur la région, mais aussi sur les sociétés occidentales dont les dirigeants ont été partie prenante de cette guerre ?
Depuis les attaques du 11 septembre 2001, toute une terminologie politique autour de la guerre contre le terrorisme s’est imposée, marginalisant le droit international et le droit humanitaire. Depuis 2001, George W. Bush, suivi par plusieurs gouvernements européens, a plongé le monde dans une phase de guerre sans ennemi concret et échappant à la géographie et à la temporalité, une guerre contre un concept, un phénomène. Cette guerre a associé le terrorisme à une identité religieuse, culturelle, essentialiste et tout acte commis par des personnes issues de l’islam ou arabes peuvent être qualifiés de terrorisme, peu importe le contexte. Les guerres sont automatiquement justifiées, d’abord en Afghanistan puis en Irak, et les États-Unis ont créé de nouvelles législations dans l’irrespect des Nations Unies et de plusieurs conventions internationales.
Les gouvernements israéliens successifs sont les premiers à profiter de cette guerre dite contre le terrorisme. En 2001, alors en plein cœur de la deuxième Intifada, Ariel Sharon déclare que « Yasser Arafat est notre Ben Laden ». La guerre coloniale qu’Israël mène dans les territoires occupés est donc considérée comme une guerre contre le terrorisme. D’autres États, comme la Russie en Tchétchénie ou les gouvernements arabes contre leurs oppositions, ont également utilisé ce prétexte du terrorisme.
« En 2001, alors en plein cœur de la deuxième Intifada, Ariel Sharon déclare que « Yasser Arafat est notre Ben Laden ». La guerre coloniale qu’Israël mène dans les territoires occupés est donc considérée comme une guerre contre le terrorisme. »
Depuis 25 ans, cette terminologie s’est installée, surtout dans les sociétés occidentales, dans leurs médias et leurs discours politiques et sécuritaires, et les Palestiniens en paient le prix, car la guerre génocidaire qu’Israël a mené à Gaza s’est justifiée des mêmes qualificatifs de terrorisme.
Cette guerre contre le terrorisme se corréle également à une explosion de l’islamophobie en Occident. Comment cela impacte-t-il la politique de l’Occident dans la région ?
L’islamophobie a évidemment joué un rôle dans le positionnement de plusieurs des acteurs en Occident par rapport au génocide des Gazaouis. On le voit surtout au niveau des droites et des extrêmes droites européennes qui tentent de faire oublier leur passé antisémite en le remplaçant aujourd’hui par un présent islamophobe. Le soutien au sionisme par les antisémites historiques permet de les « blanchir », tout en appliquant aux musulmans les mêmes mécanismes de la judéophobie. À cela s’ajoutent les discours civilisationnels cherchant à définir la guerre israélienne comme une guerre commune contre la « barbarie ».
Après deux ans de guerre menée par Israël sur de multiples fronts, peut-on parler d’une toute puissance israélienne dans la région ?
Militairement parlant, on peut évoquer une toute puissance israélienne dans la région. Israël est une entité extrêmement militarisée capable, par son armement sophistiqué, fourni principalement par les Américains et les Européens, de détruire, d’occuper et d’envahir. Il apparaît également comme un État impuni, en attestent les vétos américains au conseil de sécurité pour le protéger, le non-respect des mandats d’arrêt contre Benyamin Netanyahou et Yoav Galant de la Cour Pénale Internationale, ou sa capacité à commettre un génocide sans aucune sanction sérieuse et sans aucun isolement international.
En revanche, Israël n’a jamais été aussi fragilisé politiquement, car il est rejeté par certains de ses « voisins » et par des acteurs des sociétés civiles partout dans le monde. On a rarement vu autant de mobilisations de la part des sociétés civiles en Occident depuis la guerre du Vietnam. Et Israël tient aujourd’hui face aux sanctions et face aux potentielles mesures de la justice internationale grâce au soutien américain. Cela aura des conséquences avec le temps et après l’actuel épisode de violence.
Quelles pourraient être les conséquences du génocide sur les relations inter-étatiques dans la région ? Une reconsidération des relations entre les pays arabes et Israël est-elle envisageable ?
Les sociétés arabes sont en état de choc, de colère et de frustration face à la situation en Palestine. Même dans les pays ayant normalisé leurs relations avec Israël, l’opinion publique reste massivement pro-palestinienne. L’exemple du Maroc est parlant : malgré les accords d’Abraham, c’est la société qui a connu le plus d’expressions de solidarité vis-à-vis des Palestiniens dans toute la région.
« Cette guerre israélienne a renforcé la conviction chez les populations du monde arabe que la majorité des gouvernements occidentaux (surtout aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni et en France) sont restés complices ou indifférents face au génocide. »
En revanche, les régimes arabes sont majoritairement restés silencieux ou impuissants, maintenant dans certains cas des liens sécuritaires avec Israël, car Israël reste un relais stratégique vers les États-Unis, perçus comme garants de leur stabilité politique et économique.
Toutefois, l’attaque israélienne contre Doha au Qatar a révélé la vulnérabilité des monarchies du Golfe, malgré leurs dépenses massives en armement américain (e.g. systèmes de défense face aux missiles), qui ont été défaillants lors de l’attaque israélienne. Cette prise de conscience a durci leur ton diplomatique et poussé Donald Trump à agir en faveur d’un cessez-le-feu.
Cette guerre israélienne a renforcé la conviction chez les populations du monde arabe que la majorité des gouvernements occidentaux (surtout aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni et en France) sont restés complices ou indifférents face au génocide. Donc même si de nouveaux gouvernements arabes peuvent envisager une normalisation vu leurs rapports avec Trump, les sociétés concernées resteront en grande partie attachées à la justice et au droit à l’autodétermination des Palestiniens.