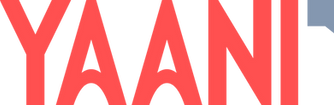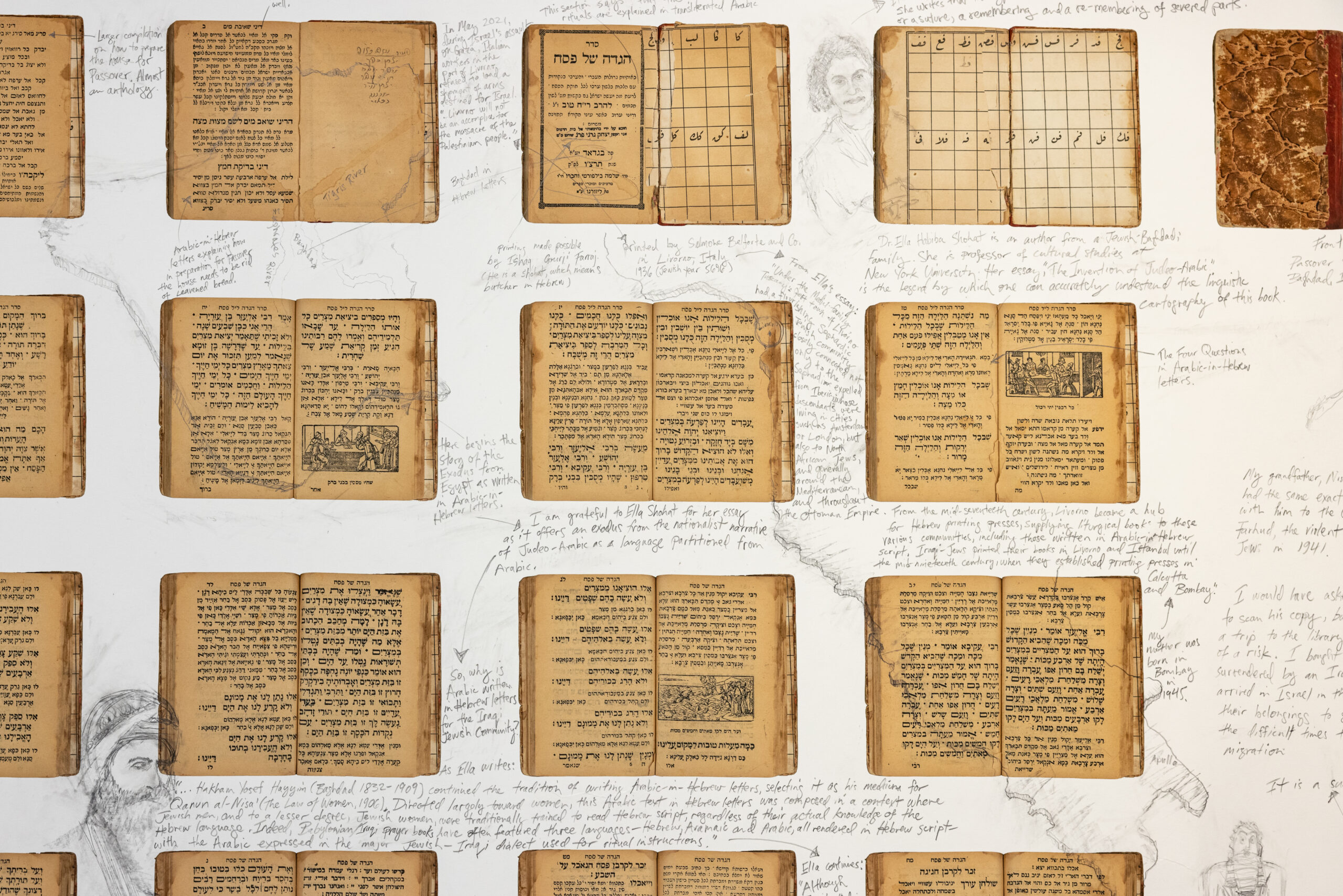Par Gregory Mauzé, journaliste et analyste politique.
La contestation interne croissante du Premier ministre Benyamin Netanyahou et de sa conduite de la guerre marque-t-elle le début d’une opposition tangible de la société israélienne à l’éradication de Gaza ? On en est loin.

Ces derniers mois ont illustré, si besoin en était, la détermination du gouvernement israélien à parachever le processus génocidaire en cours à Gaza. La rupture unilatérale de la trêve avec le Hamas le 18 mars a, en particulier, fait tomber le voile sur son désintérêt pour le sort des captifs du 7 octobre, dont la libération est au contraire la priorité de l’opinion. Le vent de la contestation d’une guerre qui aurait « perdu son sens » a alors pris une ampleur inédite, comme en atteste le taux record de 20 % de désertions dans l’armée.
Fait notable, plusieurs centaines de manifestants ont protesté le 5 janvier devant le ministère de la Défense en brandissant non pas les photos d’otages, mais d’enfants tués à Gaza, chose inimaginable au début du conflit.
Chez nous, le traitement médiatique de ces développements a accrédité l’idée d’un « réveil collectif » des Israéliens, selon les termes du correspondant de France Télévisions au Proche-Orient, et donc d’une prise de conscience des souffrances infligées aux Gazaouis. À l’appui de ce récit, les déclarations d’une série de figures réputées modérées, qui avaient jusqu’à présent contribué au consentement à l’écrasement de l’enclave côtière, telles qu’Élie Barnavi. « J’ai honte pour mon pays », confessait, le 26 mai sur le plateau de C Ce Soir, celui qui préconisait, aux premiers jours du conflit, de « soumettre Gaza à un tapis de bombes sans se poser de questions ».
Un œil plus attentif oblige toutefois à constater que l’idée d’une renaissance progressive du « camp de la paix » relève du fantasme. Si l’impopularité de la coalition au pouvoir est réelle, le consensus sur le choix de la brutalité pure face aux Palestiniens reste solide, et la réaction publique contre ceux qui tentent de l’ébrécher, impitoyable. En témoigne le torrent d’indignation qu’ont suscité les déclarations du leader de la « gauche sioniste » Yair Golan le 20 mai dernier. « Un pays sain ne fait pas la guerre à des civils, n’a pas pour hobby de tuer des bébés, ne se fixe pas pour objectif d’expulser des populations », avait affirmé celui qui, comme Barnavi, a activement participé à l’union sacrée – préconisant dès le 13 octobre d’affamer Gaza.« Calomnie antisémite », éructa aussitôt Netanyahou, tandis que Benny Gantz, autre ténor de l’opposition, l’accusa de « mettre en danger la liberté de nos héroïques combattants ».
Atmosphère génocidaire
Ces levées de boucliers prennent sens au regard de la profonde déshumanisation des Palestiniens dans le discours public, laquelle justifie toutes les atrocités qui leur sont infligées. Ainsi, on ne compte plus les déclarations génocidaires de membres du gouvernement, loin d’être circonscrites à ses franges les plus extrêmes, et qui constituent autant de pièces à charge pour la justice internationale. À la cheffe des opérations humanitaires de l’ONG Natan, Sharon Shaul, qui s’exprimait sur le sort des civils lors d’une audition le 8 mai à la Knesset, le Parlement israélien, les élus de la majorité répliquèrent avec fureur. « Je ne suis pas sûr que vous parliez pour nous quand vous dites que nous voulons soigner chaque enfant et chaque femme […] Quand on se bat contre un groupe comme celui-ci, la distinction qui existe dans un monde normal n’existe plus », s’exclama le député Amit Halevi, membre du Likoud, parti de Netanyahou.
« Selon un sondage publié en mai par la Pennsylvania State University, 82 % des Juifs israéliens seraient favorables à l’expulsion des habitants de Gaza et 56 % à celle des Palestiniens citoyens d’Israël. »
L’opposition n’est pas en reste. En septembre 2024, Meirav Cohen, du parti Yesh Atid de l’ancien Premier ministre Yaïr Lapid, fustigea le gouvernement pour avoir laissé entrer des camions humanitaires à destination des civils gazaouis. « La seule menace à laquelle ils font face, c’est l’obésité », déclara-t-elle en commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset, alors même que près d’un quart de la population était déjà confronté au stade de famine le plus avancé, selon l’IPC.
Cette atmosphère de haine prédomine également dans les médias locaux, notamment sur la chaîne d’extrême droite Channel 14, deuxième en termes d’audimat, dont le racisme et l’incitation au génocide constituent les morbides marques de fabrique. À en croire les enquêtes d’opinion, ce climat concerne, dans une large mesure, l’essentiel de la population israélienne, à rebours des narratifs opposant une majorité déboussolée à une minorité d’extrémistes. Selon un sondage publié en mai par la Pennsylvania State University, 82 % des Juifs israéliens seraient favorables à l’expulsion des habitants de Gaza et 56 % à celle des Palestiniens citoyens d’Israël.
Plus glaçant encore, près de la moitié (47 %) soutiendraient même l’extermination des civils dans les villes ennemies conquises.
Société coloniale et déshumanisation
Cette terrifiante radicalisation de l’opinion ne saurait s’expliquer par le seul traumatisme collectif du 7 octobre. « En réalité, elle révèle des tendances longtemps en gestation dans la société israélienne, nourries par l’éducation, les médias et les institutions », note Tamir Sorek, qui a conduit l’enquête, dans un article co-signé avec Shay Hazkani dans Haaretz. « Le sionisme, comme d’autres projets coloniaux, est confronté à la résistance des populations autochtones et peut glisser vers l’extermination pour assurer une sécurité absolue. »
Comment, dès lors, interpréter la soudaine préoccupation pour la situation des civils à Gaza de ce segment minoritaire de la société israélienne tant prisé des médias occidentaux ? Sans contester le fait qu’une part de cette indignation soit sincère, celle-ci doit aussi être comprise sous un angle plus prosaïque. « La frange d’Israël la plus dynamique et ouverte au monde, la “Start-up Nation”, sait à quel point l’image d’Israël en Occident est fondamentale », explique le chercheur Thomas Vescovi. « C’est pour ça qu’elle s’était dressée contre les réformes illibérales de Netanyahou ces dernières années et qu’elle manifeste aujourd’hui des signes d’opposition à la guerre à Gaza. Non pas parce qu’elle considèrerait celle-ci comme foncièrement illégitime, mais parce qu’une partie des soutiens internationaux traditionnels sont en train de décrocher. Elle cherche donc à faire vivre l’illusion qu’un autre Israël est possible à côté des extrémistes actuellement au pouvoir. »
« Ces fausses représentations d’un ‘camp de la paix’ entravent paradoxalement la perspective d’entrevoir un avenir commun entre la Méditerranée et le Jourdain. Ce malentendu entretient l’idée d’une potentielle évolution naturelle d’une démocratie coloniale et éloigne, par voie de conséquence, des mesures nécessaires pour mettre fin aux politiques criminelles imposées aux Palestiniens.»
Le sondage de juin 2025 de l’Israel Democracy Institute (IDI) apporte un éclairage intéressant sur les arrière-pensées de ce « sursaut humaniste », au regard, en l’espèce, du mécontentement international à la suite de l’instauration d’un blocus humanitaire complet à Gaza depuis le 2 mars. Alors que seuls 20 % des sondés estiment qu’il faut prendre en compte la souffrance des Palestiniens dans la conduite des opérations militaires, 30,5 % jugent qu’il convient d’augmenter le flux d’aide à Gaza « compte tenu de la pression exercée par plusieurs pays ».
Poser les bons constats
Ce constat accablant n’enlève rien au courage de ceux qui ont très tôt défié le consensus génocidaire. Ainsi, des militants du bloc anti-occupation, de la coalition Peace Partnership initiée par la gauche radicale ou de l’organisation Standing Together se sont récemment illustrés en assurant la protection des convois humanitaires vers Gaza que cherchaient à entraver des groupes de droite. Au demeurant, l’état de l’opinion publique, aussi radicalisée soit-elle, n’est pas immuable. « Dans les années 1980 et au début des années 1990, deux tiers des Israéliens étaient favorables à l’idée d’encourager les Arabes à émigrer. En l’espace de quelques années seulement, à la suite des accords d’Oslo en 1993 et de la création de l’Autorité palestinienne, le soutien à l’annexion de la Cisjordanie et de Gaza et à l’expulsion de leurs populations n’était plus que de 11 % », rappellent plusieurs universitaires dans une tribune parue dans Haaretz.
Reste que monter en épingle des marques d’humanisme encourageantes, mais marginales à l’échelle de la société israélienne, tend à minimiser son consentement à l’anéantissement de Gaza. Ce malentendu entretient l’idée d’une potentielle évolution naturelle d’une démocratie coloniale et éloigne, par voie de conséquence, des mesures nécessaires pour mettre fin aux politiques criminelles imposées aux Palestiniens, au premier rang desquelles la pression internationale.
Au surplus, ces fausses représentations d’un « camp de la paix » entravent paradoxalement la perspective d’entrevoir un avenir commun entre la Méditerranée et le Jourdain. Comme le soulignait le juriste Johann Soufi sur X le 24 mai dernier, la déresponsabilisation de la société israélienne qu’elle engendre fait en effet obstacle à la fois à sa remise en cause et à la reconnaissance collective des torts infligés. « Un jour, pour obtenir la paix et la réconciliation, il faudra passer par un processus de justice transitionnelle : avec vérité, justice, réparation et des réformes profondes de chaque côté. Mais cela commence par la vérité ! » Et donc, par un examen lucide de la nature de la relation entre oppresseurs et opprimés, aussi difficile à admettre soit-il pour les premiers.
***
post-scriptum : Le soutien à la guerre contre l’Iran, révélateur de l’union militariste
Le conflit de 12 jours opposant l’Iran à Israël du 13 au 24 juin a brusquement fait taire les dissensions existant dans la société israélienne quant à stratégie poursuivie à Gaza. Selon un sondage express publié le 19 juin par l’IDI, pas moins de 82% de la population juive israélienne soutenait le choix de Benyamin Netanyahou d’ouvrir un nouveau front meurtrier contre Téhéran. Les principaux médias du pays, fidèlement alignés sur la communication de l’exécutif, partagent cet unanimisme, de même que l’ensemble du spectre politique sioniste israélien. Quant aux « résistants de la dernière heure » au massacre à Gaza, se tiennent désormais eux aussi au garde-à-vous. Le jour de l’entrée en vigueur de la trêve, Élie Barnavi, se félicitait ainsi du « pari brillamment réussi » du gouvernement israélien, reprenant sa propagande mensongère sur l’imminence de la menace iranienne — une menace par ailleurs démentie tant par l’AIEA que par les services de renseignements étatsuniens.
Peut-on dresser un parallèle entre cet unanimisme guerrier et les velléités exterminatrices ciblant les Palestiniens ? La comparaison a certes ses limites, le climat de haine génocidaire en œuvre à Gaza et en Cisjordanie s’appuyant sur des décennies de déshumanisation propre à un régime d’apartheid. Néanmoins, on retrouve face à l’Iran l’idée qu’Israël constituerait une « villa dans la jungle » dont la survie justifierait de s’affranchir de toute barrière légale, voire morale. Selon l’IDI, seuls 22 % des Juifs israéliens estimaient ainsi qu’il fallait, dans la conduite des opérations, tenir compte de la souffrance des civils iraniens – alors même que les autorités israéliennes appelaient officiellement ces derniers à se soulever contre les mollahs. Il s’agit d’un chiffre plus élevé d’à peine 2 points que celui de ceux qui considéraient quelques semaines plus tôt que des préoccupations similaires devaient prévaloir pour les « animaux humains » de Gaza.
Cette tolérance massive aux dévastations ainsi infligées doit être en mise en parallèle avec l’objectif de cette opération fondée, in fine, sur l’opposition à un règlement pacifique du contentieux nucléaire iranien : empêcher la réintégration de la République islamique dans le concert des Nations. En d’autres termes : refuser d’envisager un autre ordre dans la région que la Pax Israelia, dans lequel Tel-Aviv imposerait ses vues à l’ensemble de ses peuples. En ce sens, l’alignement de la société israélienne sur le choix d’attaquer l’Iran, tout comme son soutien à l’effacement des Palestiniens, relève du même rapport colonial à son environnement.